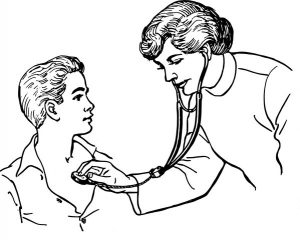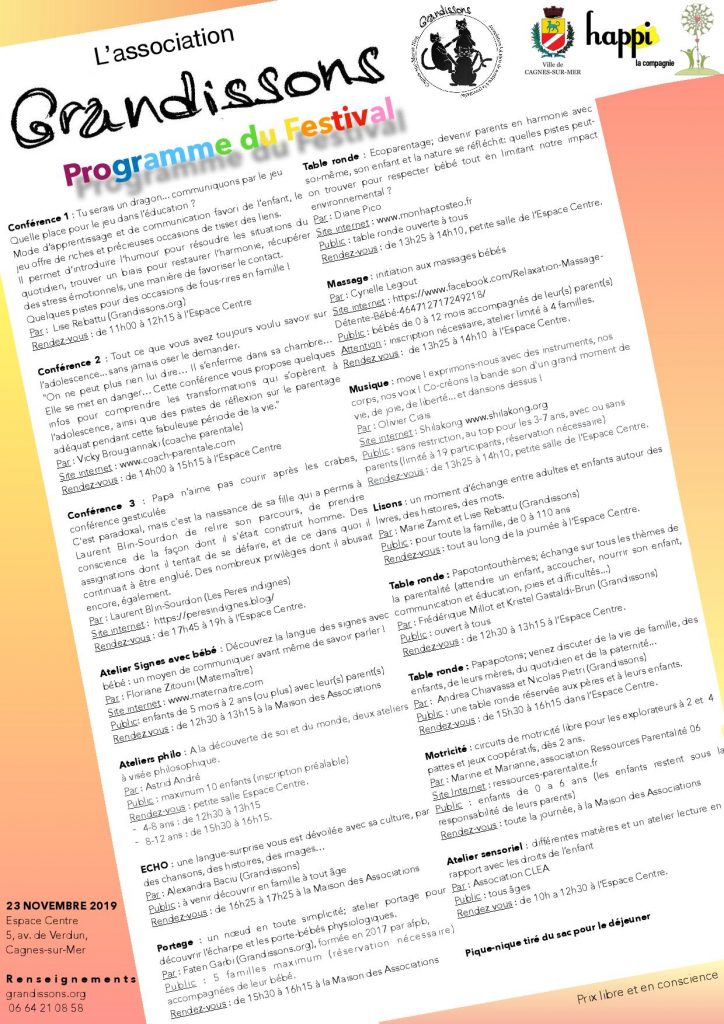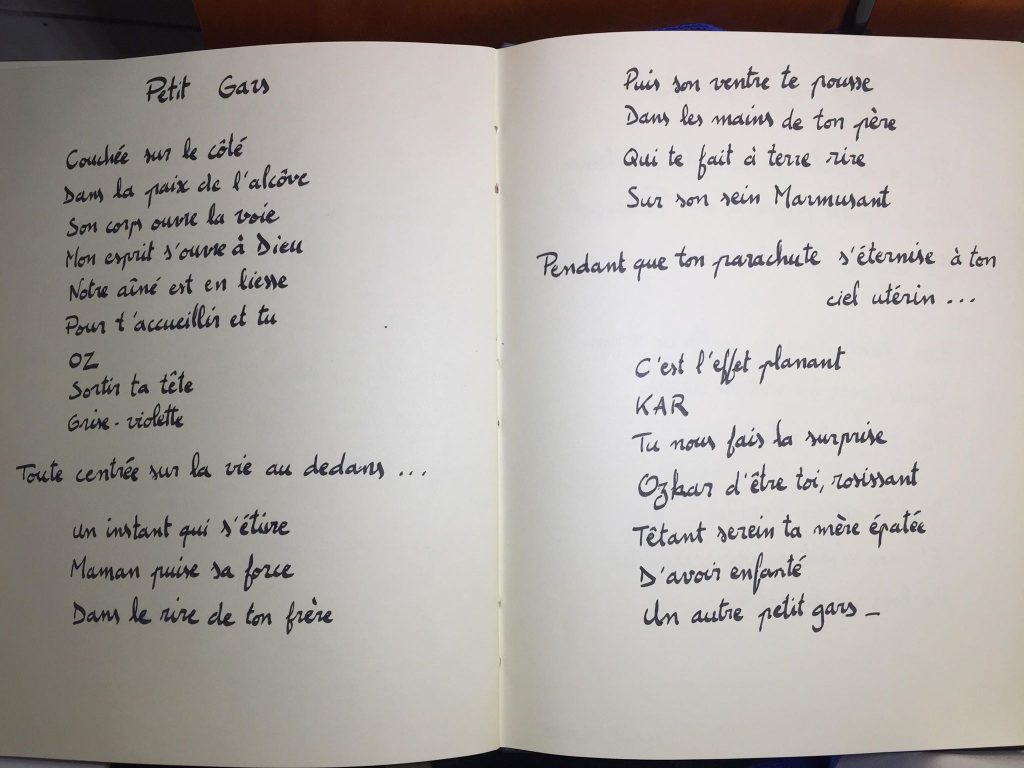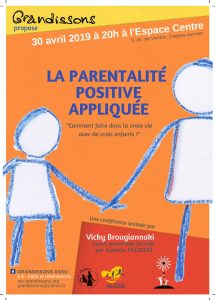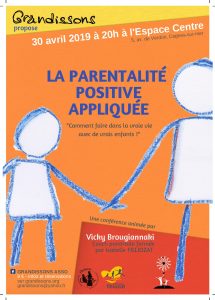Conférence de Vicky Brougiannaki, coach parentale à Cagnes-sur-Mer
Par Lise
Après avoir présenté l’association Grandissons, Marie Zamit décrit à l’assemblée la Journée de la Non-Violence Educative, initiée en 2004 par Catherine Dumonteil-Kremer. C’est l’occasion de s’interroger sur nos propres pratiques éducatives en tant que parents ou professionnel de la petite enfance et de partager des pistes de réflexion sur l’éducation bienveillante.
Marie présente une description des VEO (Violences Éducatives Ordinaires) et de leurs conséquences, achevant son discours en notant qu’il est incroyable que des études soient nécessaires pour dire que le fait de frapper un enfant, être sans défense, est néfaste.
Les VEO se définissent comme toutes les négligences et privations, les violences physiques (fessée, gifle, oreille tirée, tape sur la main, pincement, cheveux tirés), verbales (cri, hurlement, insultes…) ou psychologiques (chantage, menace, moquerie, dénigrement, humiliation, culpabilisation, retrait d’amour, menace d’abandon, isolement…) qui sont utilisées et parfois même recommandées contre les enfants pour corriger un comportement que l’adulte juge inadapté ou inapproprié.
Outre les effets à court terme, les effets à long terme sont désormais étudiés et nommés : frein du développement cognitif, accroissement de l’agressivité, effets nocifs sur l’état de santé (mémoire, système immunitaire, hypertension, problème de peau…), accroissement des risques de suicide à l’âge adulte, cancer, troubles cardiaques, asthme, dépression…
Les enfants sont en France la seule catégorie d’êtres humains que l’on peut frapper impunément. En effet, 85% des parents français la pratiquent, 71,5% donnent une «petite gifle». La moitié frappent avant 2 ans, les trois quart avant 5 ans.
Pourtant, souligne Marie, les VEO sont terreau de la maltraitance : 75 % des maltraitances ont lieu dans un contexte de punitions éducatives corporelles.
Au niveau de la législation, la France est très en retard : dans le monde, 54 pays ont interdit toute forme de punition corporelle. Cependant on avance car l’Assemblé Nationale et le Sénat ont adopté chacun une proposition de loi de Lutte contre toutes les violences éducatives ordinaires ces derniers mois. Et Marie achève en insistant sur l’importance de l’enjeu, en constatant qu’en Suède, où les violences éducatives ordinaires sont interdites depuis 40 ans, 76 % des enfants n’ont jamais reçu de châtiment corporel contre seulement 8 % en France.
Elle conclut en déclarant : élever ses enfants autrement revient à créer les fondements d’une autre société.
Vicky Brougiannaki est mère de deux enfants, et a commencé dès lors à s’interroger sur les particularités de la relation adulte enfant, n’ayant pas envie d’assumer un rôle parental basé sur l’autorité et la peur. Sentant poindre chez elle des réflexes de violence éducative, elle se donne comme mission de les remplacer par une réflexion sur l’éducation. Ces questionnements la passionnent tellement qu’elle décide de se former au coaching parental auprès d’Isabelle Filliozat, pour pouvoir transmettre une autre vision de l’éducation. Aujourd’hui elle continue à réfléchir et à apprendre sur la parentalité, mais aussi à militer auprès d’associations pour que tous les enfants aient droit à une éducation sans violence. Elle reçoit à Cagnes-sur-Mer et propose des ateliers de parentalité.
LA PARENTALITE POSITIVE APPLIQUEE
Vicky commence par revenir sur les terme du titre de sa conférence : la parentalité positive appliquée :
– Positive : elle souligne que cet adjectif ne lui convient pas totalement, et moins encore ceux de bienveillante, respectueuse : le malaise provient du fait qu’ils peuvent sous-entendre qu’il existe une parentalité contraire (malveillante, négative…) Mais ce débat sur le terme permettra, espérons-le, d’en trouver un qui convient, avant que, dans l’idéal, cette parentalité devienne normale au point de ne plus avoir besoin d’être qualifiée.
– Appliquée : l’importance de se montrer concret naît du fréquent reproche fait à ce type de parentalité d’être parfait en théorie, mais impossible à appliquer au quotidien.
A tout moment de sa conférence, Vicky nous invite à aller vérifier ce qu’elle dit et nous informer pour nous faire un avis basé sur des connaissances et des recherches.
La conférence débute par une partie théorique : Vicky insiste sur l’importance de comprendre les notions, de les connaître, de les assimiler, pour ne pas être en permanence en train de réfléchir.
On peut en effet être accaparé de questions au moment d’interagir avec l’enfant, ce qui enlève du naturel à la situation, d’où l’importance de bien intérioriser le concept en amont.
Il est fréquent de reproduire en première intention l’éducation que nous avons reçue. En changeant notre manière d’entourer nos enfants, nous pouvons espérer que d’ici deux générations, plus personne ne dira qu’il a reçu des coups pour son bien ! Au début de notre parentage, nous sommes les parents que nous avons eus : pensons à nos petits-enfants pour changer.
Qu’est-ce que la violence ?
Vicky nous pose de nombreuses questions sur la violence : comment la définir ? Est-elle absolue ? Relative ? Contextuelle ? Toute violence est-elle condamnable ? Tout acte apparemment violent l’est-il ? La violence est-elle toujours visible ? A chacun de chercher ses propres réponses à cette difficile question…
Elle nous explique que la violence naît immanquablement dans les rapports de force. Dès qu’il y a un rapport dominant-dominé : le risque de violence est grand, à toute échelle, que ce soit dans la lutte des classes, les dictatures, le contexte social…
Ainsi, il est primordial de se poser cette question : suis-je avec mes enfants ou mes élèves dans une relation dominant-dominé ? Si oui, il est certain que j’exercerai de la violence.
Ce qui amène cette violence, ce sont les freins que nous avons pour mettre en place cette autre parentalité, dite «positive».
Les causes des VEO
* VEO : violences éducatives ordinaires
– Le poids de la culture : dans notre pays, il est admis que l’on peut faire certaines choses aux enfants de manière normale (humilier y compris en public, sans choquer personne…) On dit «Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse»… sauf aux enfants !
Où est la limite entre violence et VEO ? Elle est culturelle : en France fessée = VEO, Suède = maltraitance. En France maintenant martinet = maltraitance, il y a 40 ans = normal…
Ainsi, notre conférencière nous décrit l’expérience d’un père français, qui vivait en Suède, où il n’avait jamais donné de fessée. Après 2 mois en France, il en a donné une. Car ce qu’on voit dans la culture environnante peut nous embarquer à nous conduire autrement…
Il est difficile de ne pas se laisser influencer par les attentes : on est porté à réagir selon ce que l’assistance attend de nous.
– Les croyances :
- Il faut corriger l’enfant, le remettre dans le droit chemin, car c’est initialement un être mauvais. Cette croyance établit un rapport purement éducatif. A partir de là, on croit que les enfants ont besoin de (cadre) et de limites, et que cet enfermement les sécurise.
- Les enfants nous doivent du respect. Et en même temps, on ne respecte pas les enfants. Et quand on ne se sent pas respecté, on rejoint notre statut autoritaire pour exiger le respect.
- Les enfants doivent nous obéir. Pourtant, les enfants ne sont intrinsèquement pas obéissants. Cette attente est incohérente : les parents aimeraient que leur enfant soit libre, autonome, ait de la volonté. Mais en attendant qu’il soit grand, on le souhaite obéissant et docile…
Toutes ces croyances sont un mode de notre cerveau pour agir vite et ne pas devoir décortiquer chaque action.
Ex : le bain. Si l’on remet en cause nos vieilles croyances, on peut se rendre compte qu’un bain quotidien est parfaitement inutile… Et qu’il n’est donc pas nécessaire d’engager une lutte pour cela.
– Nos réflexes éducatifs (tels un «pilote automatique», ils permettent d’aller vite, induisent des réflexes irrépressibles). Il reste pourtant possible de les reprogrammer.
– Nos propres émotions : souvent exacerbées et disproportionnées, car on expérimente avec nos enfants l’impuissance, cette sensation insoutenable qui induit du stress, bloque toute porte de sortie. Impuissance + colère : rage, impuissance + tristesse= désarroi, impuissance + peur = terreur…
Pourtant, nos émotions nous sont utiles et sont à notre propre service. Par exemple, si l’un de nos enfant tape sur l’autre : on crie; cela est utile à notre amygdale, puisque le fait de proposer une action (cri) fait baisser notre stress. Par contre, ça n’a pas été utile à l’enfant qui a tapé ni à celui qui s’est fait taper.
Sortir de ces habitudes
Quelques clés pour dépasser ces difficultés nous sont ensuite énumérées :
– En ce qui concerne la culture, on ne peut pas en sortir individuellement, ni la modifier : on peut cependant choisir d’agir différemment.
– Pour ce qui concerne les croyances : il est essentiel de se renseigner (les connaissances de neurosciences permettent en particulier de traduire mieux le comportement des enfants)
– Reprogrammer les réflexes peut probablement se faire via des thérapies (PNL, hypnose ?…), mais une autre solution est, quand on a une réaction inadaptée, de se demander ce qui aurait été pertinent. Qu’est-ce qui aurait permis à mon enfant de grandir ? Cet exercice constant permettra, la prochaine fois, de sortir la réaction pertinente plus facilement, puisqu’on se l’est déjà figurée. Cela devrait rentrer, s’automatiser d’une fois sur l’autre. Il s’agit de commencer à se comporter en conscience (au début, on a l’impression de faire semblant) pour évoluer vers un savoir-faire qui nous pénètre et devient un savoir-être (comme l’apprentissage d’une langue étrangère).
– La compréhension, la gestion de nos émotions est un sujet qui mérite un approfondissement (des stages sont proposés…), car nous n’avons souvent pas été éduqués à cela. On y est même souvent hostiles («si tu es en colère, tu vas dans ta chambre», «t’es pas beau quand tu boudes», ou, à un enterrement, en France, considérer qu’«elle a été très digne, elle n’a pas pleuré» (alors que pleurer est une manifestation de tristesse, n’ayant rien à voir avec la dignité !)). Ces émotions, que l’on devrait pouvoir se communiquer entre humains, nous permettent d’évoluer dans notre relation au monde. Ainsi, nombreux sont les parents qui ont envie d’alphabétiser émotionnellement leur enfant, mais ne savent pas eux-mêmes comment faire.
Que propose la parentalité positive?
Vicky Brouginnaky nous propose à ce stade un bref comparatif des manières dont on peut analyser et considérer les manifestations de notre enfant, selon le genre de parentalité dans lequel on choisit de se positionner.
| Parentalité classique | Parentalité positive |
| L’enfant est un être de pulsions | L’enfant est un être de besoins |
| L’enfant grandit grâce aux castrations successives (frustrations) | L’enfant grandit selon la satisfaction de ses besoins. |
| Caprices… | Besoin non identifié, émotion, stress |
| Punir, poser des limites | Identifier et nourrir les besoins |
| Corriger le comportement | Traiter le problème |
Ainsi le terme de «caprice» est utilisé de manière péjorative, sous-entendant que l’enfant cherche à faire quelque chose de pas net : il désigne un comportement excessif de l’enfant dont l’adulte n’arrive pas à comprendre la logique. Alors que, d’un autre point de vue, on peut simplement considérer ce genre de manifestation comme le besoin non identifié d’un enfant empli d’une émotion, d’un stress…
Punir, c’est modifier le comportement de l’enfant en imposant des limites par une frustration volontaire. On croit qu’en l’amenant à «réfléchir», il va changer son comportement. Alors que c’est comme la fièvre : on ne devrait pas se préoccuper de la fièvre en soi, mais de ce qui la cause, au lieu d’éloigner, chercher le besoin et le nourrir, pour permettre à l’enfant d’avancer…
Les deux piliers de la parentalité positive
– La conviction que les enfants sont des personnes à part entière qui ne nous appartiennent pas et sur lesquels nous n’avons pas de droits.
– L’idée que lorsqu’il y a un problème, on cherche quel est-il en profondeur, et pas uniquement dans sa manifestation.
Souvent, on note une confusion entre parentalité positive et laxisme, on pose la question des limites…
Vicky nous propose en premier lieu de redéfinir le rôle parental : quels sont nos droits en tant que personne et nos devoirs en tant que parent ?
– Lorsque je fais valoir mes droits face à mon enfant, je le fais en tant que personne, dans une relation horizontale.
– Lorsque je fais mon devoir , je le fais en tant que parent, dans une relation verticale (car mon enfant est dépendant de moi).
Pour une relation équilibrée, c’est toute la structure relationnelle que nous avons avec l’enfant qui doit être changée, et pas seulement les mots utilisés. Il faut sortir du rapport de force, renoncer à l’autorité, qui est un privilège, lequel conduit à la violence.
Quand on agit avec autorité, la relation devient verticale. Alors que l’on peut constater qu’au quotidien, lors de notre relation horizontale avec d’autres adultes, ça roule, sans que personne prenne le dessus.
Induire la peur se révèle très néfaste, posant des barrières au niveau du développement de l’enfant, induisant du stress…
Il est possible de répondre à la dépendance de quelqu’un tout en le respectant (par exemple, on ne punit pas sa vieille mère dépendante si elle renverse son verre…)
Certains pourraient répondre qu’on doit pourtant éduquer les enfants, et non sa vieille mère…
Éduquer quelqu’un, nous dit Vicky, c’est avoir un projet pour cette personne : est-ce éthique ? nous demande-t-elle.
Après avoir offert un temps de réflexion à l’assistance et l’avoir encouragée une fois de plus à se forger sa propre opinion, oui, nous répond-elle, de sa propre opinion, cela l’est : il appartient à notre rôle de parent d’offrir à notre enfant la transmission des codes nécessaires à la compréhension de son environnement, des outils pour cette adaptation, ainsi que nos valeurs (celles-ci étant de fait transmises naturellement).
Imaginons, poursuit-elle, qu’on accueille un étranger (venue d’Amazonie ou d’il y a 200 ans) : on fera de la transmission, on lui expliquera, on n’aura pas idée de le punir parce qu’il n’aura pas dit merci, ne se sera pas conformé à une règle sociale qui lui est inconnue ou incompréhensible.
Ainsi, on doit à notre enfant protection et transmission (vieille mère + étranger) : je te respecte comme un adulte, je te protège, et je te transmets les codes nécessaires à ton adaptation sociale.
Les contraintes
Le cerveau de l’enfant est immature. Au quotidien, on doit tout le temps imposer des contraintes, interdire, demander…. Comment savoir lesquelles des contraintes que nous imposons sont légitimes ?
Il s’agit d’observer attentivement si cette contrainte entre dans le champ de notre responsabilité parentale.
– Droits : je les exerce en ma faveur.
– Devoirs parentaux : en faveur de mes enfants.
Les contraintes ne sont pas agréables et souhaitables, mais font partie de la vie, et sont parfois nécessaires, donc légitimes, dans trois cas :
– La santé (physique et mentale)
– La sécurité : usage protecteur de la force* (incomparable à un usage répressif), par exemple pour attacher la ceinture en voiture, enlever un couteau à un bébé…
*terme utilisé par Marshal Rosenberg, fondateur de la CNV
– La préservation des libertés des autres : les enfants ne peuvent pas endosser eux-mêmes cette responsabilité. Par exemple, si notre enfant crie au théâtre : c’est notre responsabilité d’adulte de le faire sortir (en lui expliquant qu’on se rend compte que cet événement n’est pas adapté pour lui, et non en présentant cela comme une punition).
Vicky met le doigt sur le pouvoir énorme que nous avons sur notre enfant : le défi est de savoir si nous, adultes, sommes prêts à y renoncer autant que possible.
Ex : une maman qui demande à son petit enfant de lui donner la main sur le trottoir, l’enfant n’obtempère pas. En observant mieux, on pourra constater qu’il n’y a pas de danger immédiat. C’est son propre stress, qui conduit la maman à faire cette demande, qui n’est donc pas tout à fait légitime et claire. Au passage piéton, la petite fille est venue donner la main sans résistance, par contre…
Quand on n’arrive pas à obtenir la coopération de l’enfant, on devrait se demander si on est légitime dans notre demande. Si non, tant mieux que l’enfant résiste. Mais si c’est légitime, dans le cadre des trois points énumérés ci-dessus, il faut passer à l’acte.
Dans ce cas, on peut rarement espérer que les explications vont suffire. Parfois, elles ne sont ni nécessaires, ni suffisantes, et peuvent même être anxiogènes.
Si l’enfant ne coopère pas malgré tout, on pourra être tenté de se dire que la parentalité positive ne fonctionne pas, et redevenir violent. Pourtant, s’il est nécessaire de passer à l’acte, il faut en assumer la responsabilité : c’est une contrainte que l’on impose, que l’enfant vivra mal, criera, et il faudra s’y attendre et l’accepter. Cela ne veut pas dire qu’on n’aurait pas dû contraindre. Mais à ce stade, on va s’occuper de l’émotion de l’enfant. Cela ne veut pas non plus dire qu’on est de mauvais parents.
La crise n’est pas un problème, c’est la manière dont on va la traiter qui peut le devenir.
Certains pourraient craindre qu’en réduisant les contraintes au minimum en se limitant à ces situations où la contrainte est considérée comme légitime, l’enfant ne perde l’habitude de coopérer… En réalité, c’est plutôt l’inverse qui se produit : moins on contraint un enfant, moins il entre en opposition.
Et moi alors ?
Ai-je le droit de faire passer mes besoins avant ceux de mes enfants ? De laisser mon bébé pour partir en vacances ? De demander à mon enfant de se taire parce que je suis fatiguée ?
Eh bien… oui, répond Vicky.
Mais comment régler les conflits de besoin que nous rencontrons immanquablement ?
Car, de fait, l’état de dépendance de nos enfants induit une réduction de notre liberté, de notre autonomie…
Tout d’abord, malgré ce que l’on peut parfois entendre, il est apaisant de reconnaître qu’il est notre devoir et notre nature de mammifère de répondre aux besoins du nouveau-né sans que cela créé un conflit de besoin. Mais à notre époque, les contraintes du travail ajoutées à cette répétée injonction «prends soin de toi» rendent les choses plus difficiles.
Notre conférencière nous propose quelques pistes :
– Ne pas se sacrifier : le ressenti de sacrifice est la manifestation d’un choix qui n’est pas assumé. Si on commence à l’éprouver, c’est qu’une partie de soi se sent lésée, et elle le fera payer un jour à quelqu’un. Il est préférable d’écouter plutôt nos émotions et de modifier notre choix, qui n’est pas, ou plus, le bon.
– Élargir les possibles/poser les besoins : comment faire dormir bébé de 6 mois pour pouvoir se reposer ? -> pas de réponse.
Poser la question autrement : quel est mon besoin ? Le repos -> donne d’autres réponses (ex : faire des micro-siestes).
– Se demander à qui appartient le problème et quel est ce problème : est-ce celui de l’enfant, le mien, notre problème à tous les deux ?
Si le problème appartient à l’adulte, on ne peut pas demander à l’enfant de s’en occuper.
S’il appartient à l’enfant (par exemple il a oublié de faire ses devoirs et il est tard), je n’ai ni à m’énerver, ni à trouver une solution. Je peux simplement compatir, l’aider à trouver une solution, devenir complice…
Quand le problème appartient aux deux (bébé de 8 mois marche à quatre pattes, maman ferme la porte pour cuisiner. Bébé se met debout contre la vitre pour entrer en manifestant son envie d’entrer. Dans la tête de la maman, une voix détestable murmure «si tu cèdes maintenant, tu ne pourras plus faire marche arrière»… C’est le problème de la mère qui a besoin de faire le repas en étant tranquille + le problème du bébé qui voulait être avec sa mère. La solution peut être de placer bébé dans la chaise haute près de sa mère. C’est ce que Thomas Gordon nomme solution gagnant-gagnant.
Parfois aussi, on met ses propres besoins de côté en faveur de l’enfant, car c’est aussi notre besoin que de satisfaire les besoins de l’enfant.
Mais parfois, l’enfant empiète sur les limites.
Il est entravé par tellement de limites naturelles (de son corps + de son cerveau + environnement immédiat + étendu + loi…), qu’il est vraiment inutile de poser des limites artificielles.
L’enfant décrit comme n’ayant «pas de limites» est celui qui vit avec des personnes dont les limites sont perméables à celles de leur enfant.
Les limites, sont définies par notre environnement : par exemple, la limite du bruit tolérable est différente selon là où on vit (appartement,maison…)
Il nous appartient de prendre soin de nos limites, et si on a à faire avec quelque chose qu’on ne supporte pas, on peut le faire respecter, tout en se demandant si l’enfant est en mesure de faire ce qu’on lui demande.
Ex : enfant qui nous interrompt quand on parle : on ne peut pas avoir la même attente selon son age.
Nous, adultes, devons prendre la responsabilité de nos propres limites.
En conclusion
Entrer dans l’éducation positive induit de changer la structure relationnelle, et pas uniquement notre manière de poser nos demande. Il s’agit de poser la légitimité de nos demandes et d’en prendre la responsabilité, et également de renoncer à l’autorité, qui abîme le lien (tout en étant patient et indulgent avec soi-même car ce changement prend du temps).
Il importe de prendre le temps de vivre des relations horizontales avec nos enfants, dans un contexte donnant-donnant, de pas vouloir investir le peu de temps qu’on a avec nos enfants de manière intense : on peut juste être avec eux, comme une personne à côté d’une autre personne…
Le site de Vicky Brougiannaki :
https://www.coach-parentale.com/